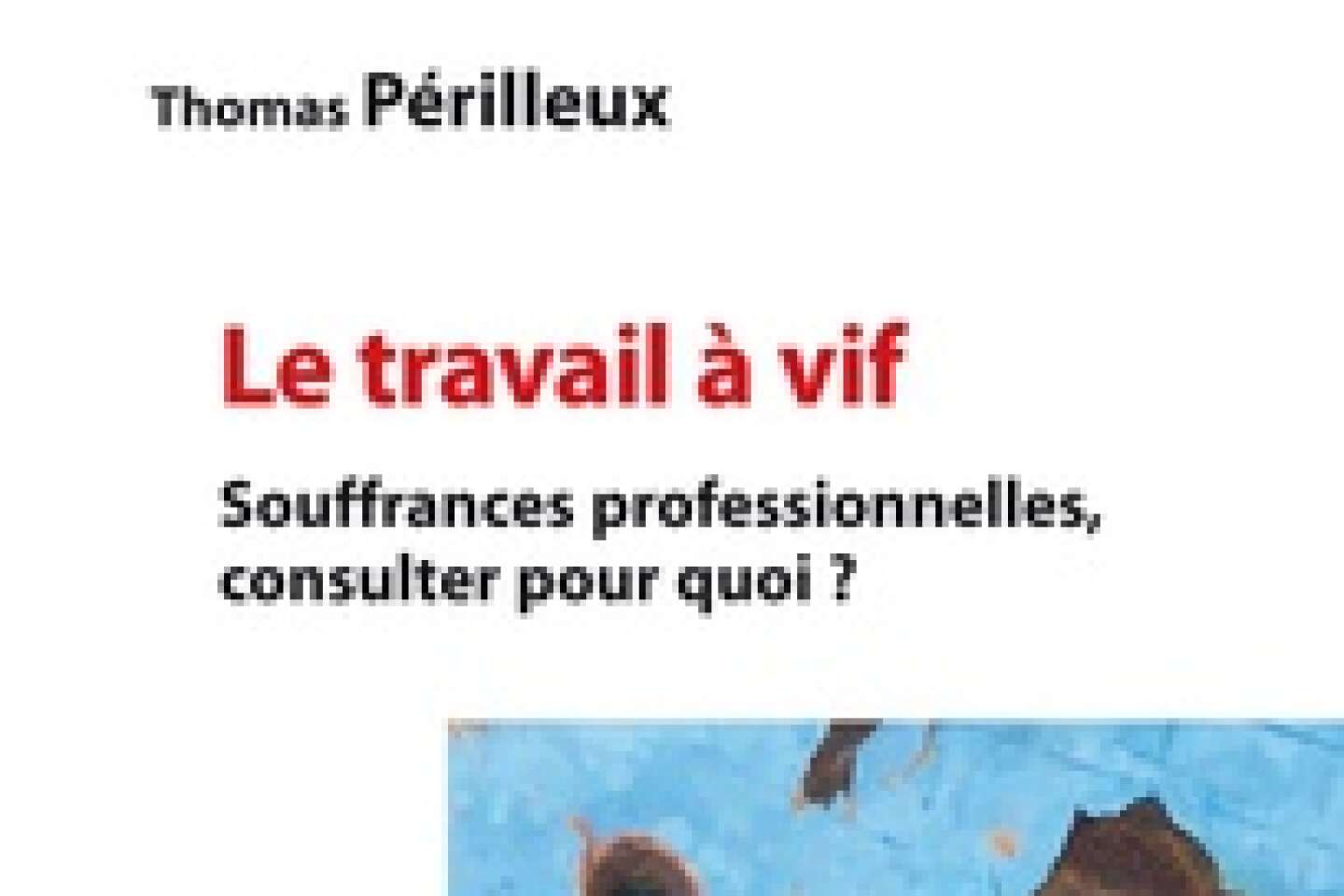La Cour européenne des droits de l’homme contraint la France à indemniser une femme condamnée pour avoir dénoncé un cas de harcèlement sexuel

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a contraint jeudi 18 janvier la France à verser 12 750 euros à Vanessa Allée, une femme condamnée pour avoir dénoncé un cas de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail.
Mme Allée avait été sanctionnée en appel en 2018 par une amende de 500 euros pour diffamation publique à l’encontre de son supérieur hiérarchique. La sentence avait été confirmée en 2019 par la Cour de cassation, qui avait ordonné le versement de 2 500 euros au titre des frais de procédure.
En 2016, la victime, secrétaire dans une association d’enseignement confessionnel, avait dénoncé, dans un courriel adressé à six personnes, dont l’inspecteur du travail, une « agression sexuelle » ainsi qu’un « harcèlement sexuel et moral » de la part du vice-président exécutif de l’association, rappelle la CEDH dans un communiqué.
La justice française estimait que les accusations d’agression sexuelle formulées par cette habitante de la région parisienne, née en 1978, n’étaient pas démontrées.
Méconnaissance de la Convention européenne des droits de l’homme
Dans son arrêt, la CEDH fait valoir que les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme doivent « apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes ».
Elle note que « les faits dénoncés ont été commis sans témoins, et que l’absence de plainte relativement à de tels agissements ne saurait conduire à caractériser [la] mauvaise foi » de la plaignante. La justice nationale a ainsi « fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle apporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer », remarque la cour.
Le courriel litigieux, quant à lui, était un texte « envoyé à un nombre limité de personnes, n’ayant pas vocation à être diffusé au public, mais dont le seul but était d’alerter les intéressés sur la situation de la requérante afin de trouver une solution permettant d’y mettre fin ».
Ce texte « n’a entraîné, en tant que tel, que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur », observent les sept juges chargés de trancher.
Ils estiment en outre donc que la France a méconnu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté d’expression.