« Sociologie des dirigeants de grandes entreprises » : l’ère des directeurs-manageurs
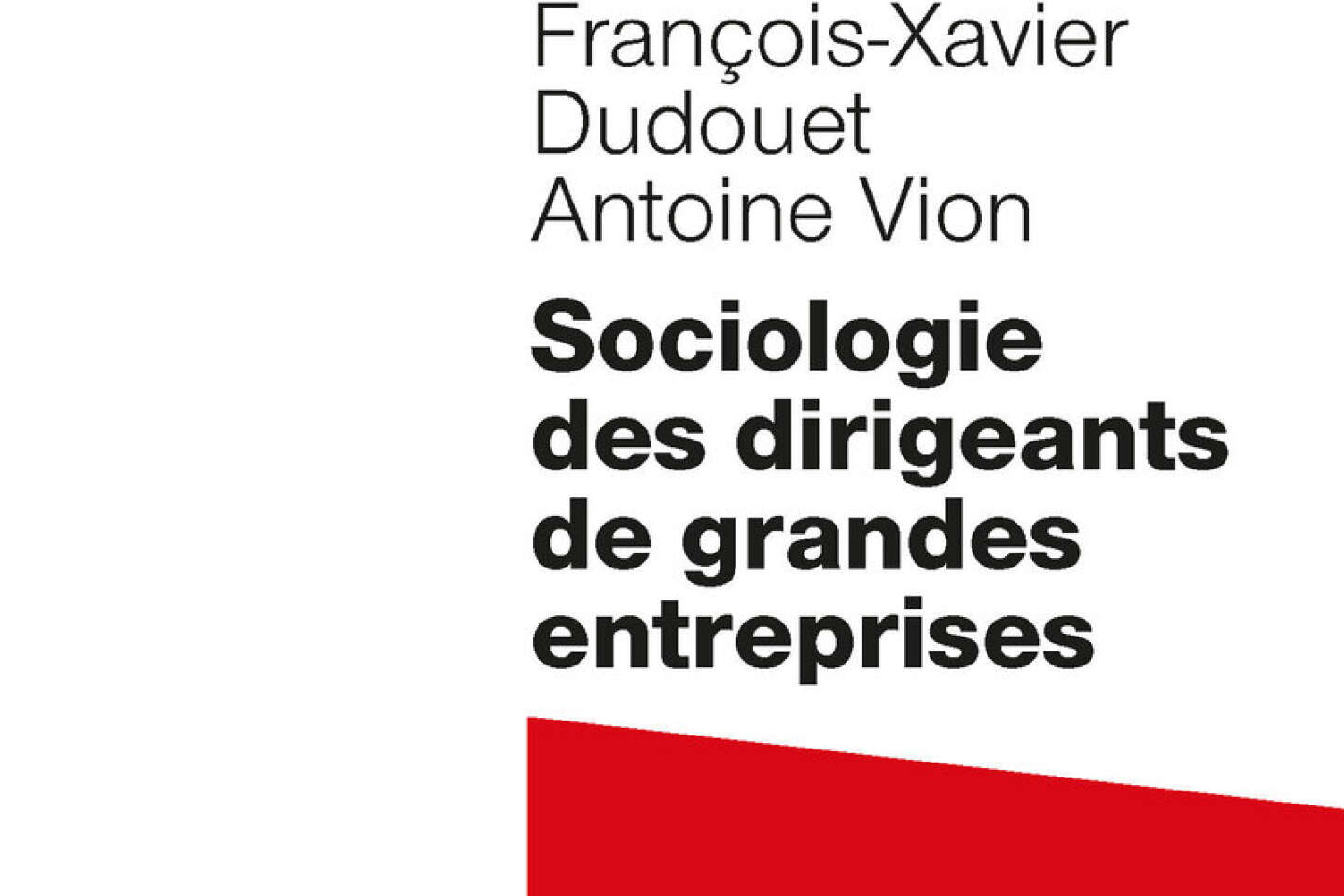
Au XIXe siècle, une rupture fondamentale apparaît dans l’histoire des organisations : les sociétés par actions émergent. Elles introduisent une évolution majeure : le patrimoine de la société (bâtiments, machines, marchandises…) est désormais strictement séparé de celui des actionnaires, constitué de la valeur des actions.
En conséquence, le patrimoine de ces mêmes actionnaires peut « être valorisé indépendamment de la firme ». Un mouvement s’est alors opéré : « Ceux-ci se sont éloignés de la gestion [des entreprises] pour laisser place à un nouveau type de dirigeants : les manageurs », expliquent François-Xavier Dudouet, directeur de recherche au CNRS, et Antoine Vion, professeur de sociologie à l’université de Nantes, dans leur ouvrage, Sociologie des dirigeants de grandes entreprises (La Découverte).
Les deux auteurs se proposent, à travers leur essai, d’analyser la transformation sociologique qui s’est alors engagée à la tête des grandes sociétés, et qui a conduit à la formation d’une « bureaucratie économique ». Pour ce faire, ils prennent appui sur les nombreuses études menées en France, mais aussi à l’étranger (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Chine…), sur le sujet, en livrant une lecture critique, pointant les faits saillants qu’elles mettent en lumière comme leurs lacunes.
Qui sont ces dirigeants ? Premier constat : leur « position ne découle plus de la propriété du capital, mais (…) dépend d’autres dispositions plus formelles et impersonnelles, comme le diplôme, la compétence et la capacité à faire carrière dans de vastes organisations ». Au fil du XXe siècle, si les « milieux populaires sont durablement tenus à l’écart » (malgré quelques exceptions, en Chine par exemple), la place prise par les enfants des classes moyennes supérieures s’étend. L’accès aux études est là fondamental avec, progressivement, une importance croissante pour les formations en administration des affaires (HEC, en France).
Logiques managériales et financières
A contrario, « la proportion d’individus succédant à leur père à la tête des grandes entreprises ne cesse de diminuer au cours du XXe siècle », indiquent MM. Dudouet et Vion. Les héritiers sont jugés de moins en moins légitimes, leur nom n’est plus un sésame. En témoigne le parcours d’Alexandre Ricard, actuel PDG de Pernod-Ricard.
Le petit-fils de Paul Ricard « a d’abord passé un entretien d’embauche au sein du groupe, au cours duquel il n’a pas convaincu », rappellent les auteurs. Renvoyé à ses études, l’homme a alors dû « fai[re] ses preuves, notamment en obtenant un MBA à la Wharton School et en passant chez Morgan Stanley puis Andersen Consulting » – en un mot, en se « managérialisant » – avant d’intégrer finalement l’entreprise familiale.
Il vous reste 28.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.








