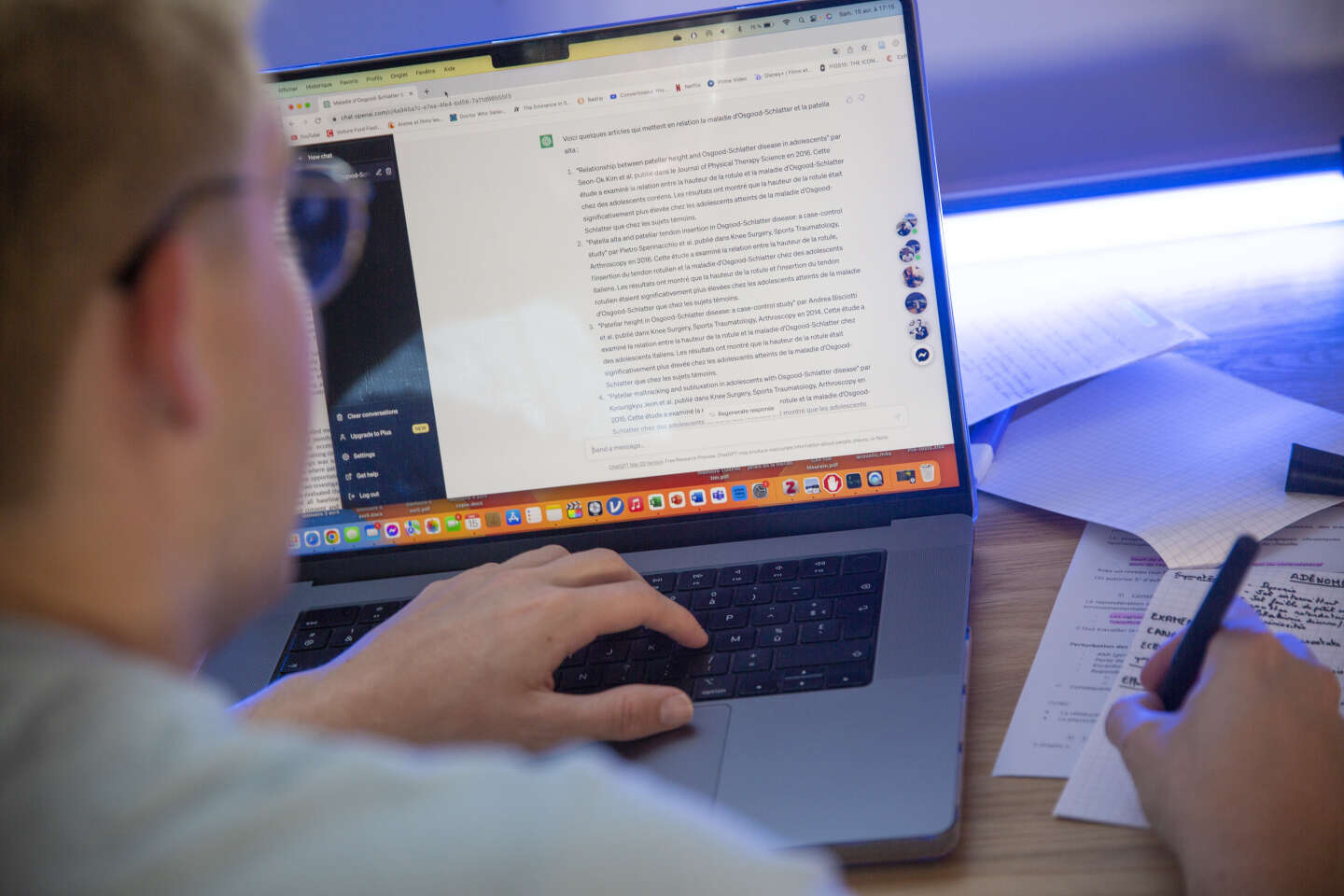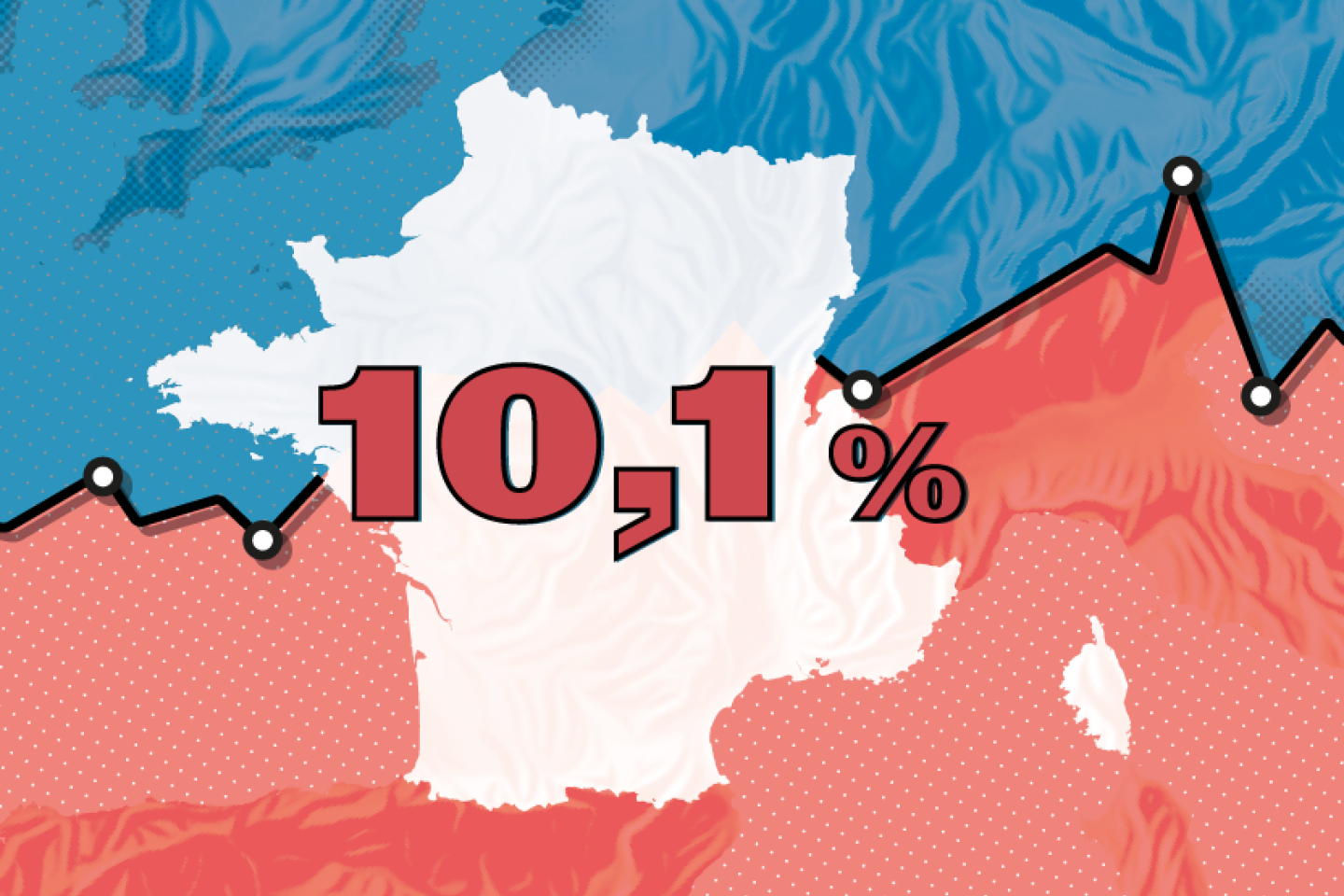« L’emploi et la transition énergétique » : le travail au défi de l’urgence climatique

Le livre. L’objectif apparaît tant ambitieux que primordial au vu de l’urgence climatique. D’ici à 2050, la France devra avoir atteint la neutralité carbone. Les conséquences s’annoncent vertigineuses sur le plan économique.
La transition énergétique impose une décarbonation à marche forcée des activités qui implique sobriété et innovation technologique, mais nécessite en même temps des « investissements majeurs et des politiques d’accompagnement ». Quelles seront les conséquences d’un tel défi sur l’emploi ? Professeur d’économie à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Mireille Chiroleu-Assouline expose ce qu’on en sait dans son ouvrage L’Emploi et la Transition énergétique (Les Presses Sciences Po).
Au fil des pages, l’autrice montre tout d’abord toute la complexité du sujet. Elle invite ainsi à se détourner d’une lecture clivée, qui présenterait la transition tantôt comme un « moyen de parvenir à une croissance verte créatrice de richesse », tantôt comme un « processus porteur d’une inévitable régression économique ».
Elle souligne combien la nuance est nécessaire, la prudence également : la littérature scientifique sur le sujet propose parfois des résultats contradictoires. Les projections sur le long terme se révèlent, par ailleurs, bien souvent délicates. Quelles seront, par exemple, les conséquences de la mise en œuvre de politiques environnementales de façon asymétrique par un pays ou un groupe de pays ? La théorie économique avance deux hypothèses : celle des « havres de pollution » (la délocalisation des activités dans des pays où les normes sont moins sévères) ou, au contraire, « l’hypothèse de Porter » (du nom de Michael Porter) selon laquelle les régulations auraient un effet stimulant sur les entreprises et, in fine, sur l’emploi.
Ampleur et rapidité
Malgré les difficultés à esquisser une vision prospective, quelques lignes fortes peuvent tout de même être tracées. L’autrice décrit ainsi la transition à l’œuvre comme un phénomène proche de la destruction créatrice (de produits, d’entreprises et d’emplois) théorisée par Joseph Schumpeter (1883-1950). Celle occasionnée par la transition énergétique se singularise par son ampleur et sa rapidité. Second constat : le bilan en termes d’emplois devrait être globalement positif, avec des progressions attendues dans des filières comme l’hydrogène ou des métiers comme ceux de la maintenance.
Ne se limitant pas à une évaluation quantitative, Mme Chiroleu-Assouline remarque que ce mouvement majeur pourra faire évoluer certains emplois qualitativement (conditions de travail, stabilité…) et entraîner une réallocation intersectorielle, mais aussi géographique (au niveau local comme international).
Il vous reste 24.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.