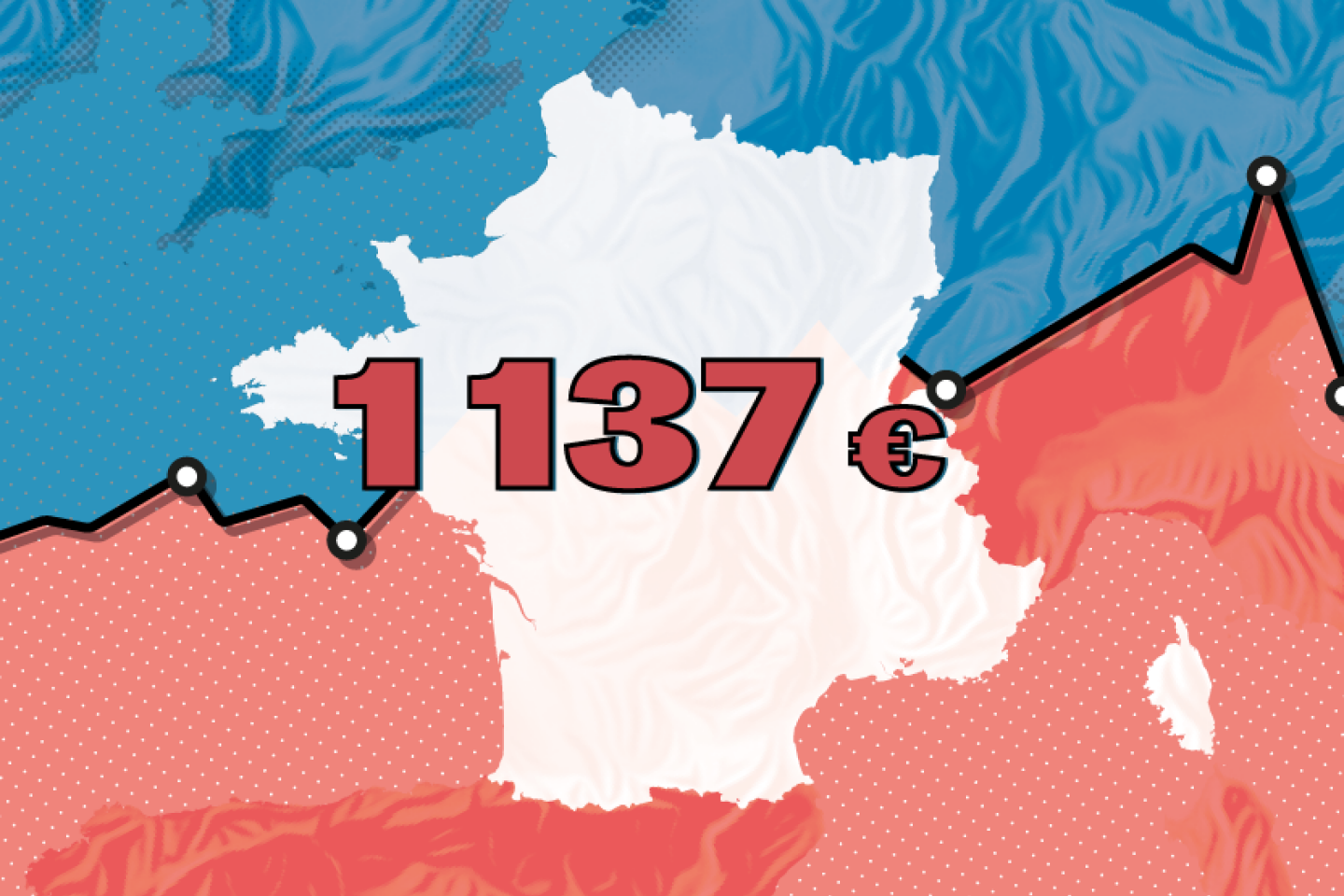Emmanuel Macron lance l’« acte II d’une loi pour la croissance » et une nouvelle réforme du marché du travail

« La France du bon sens plutôt que la France des tracas. » C’est avec ce slogan qu’Emmanuel Macron a résumé, mardi 16 janvier au soir, sa volonté de refaire de la simplification du quotidien des chefs d’entreprise une priorité, pour « libérer davantage encore ceux qui font, qui innovent, qui osent ».
« Il y a encore trop de complexité qui décourage les entrepreneurs, les industriels, les commerçants, les agriculteurs, les artisans. (…) Et nous ne pouvons plus nous le permettre. C’est pourquoi je demande au gouvernement de supprimer des normes, réduire des délais, faciliter encore les embauches, augmenter tous les seuils de déclenchement d’obligations », a déclaré le président de la République, en demandant « un acte II d’une loi pour la croissance, l’activité, les opportunités économiques ».
Renouant ainsi avec l’Emmanuel Macron qui, ministre de l’économie de François Hollande, avait porté, en 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Mieux connue sous le nom de « loi Macron », elle avait permis notamment la création de ces lignes de bus à travers la France, ou « cars Macron », facilité le travail du dimanche ou de nuit, ou ouvert des professions réglementées comme les notaires.
Des règles d’indemnisation du chômage « plus sévères »
Qu’en sera-t-il cette fois ? Depuis novembre 2023, Bercy a justement lancé une grande consultation de chefs d’entreprise sur le sujet, avec la perspective d’un projet de loi « avant l’été ». C’est ce dernier – rebaptisé « Macron 2 » et présenté courant mars – qui devrait servir de base à cette volonté de simplification, précisent l’Elysée et Bercy.
Mais la consigne était plus à l’identification de petits « tracas » du quotidien, pour reprendre l’expression de M. Macron (tel document administratif illisible, telle norme problématique), qu’à une réforme d’ampleur. Quant au « guichet unique » déjà créé par la loi Pacte en 2019, pour faciliter les démarches, la Cour des comptes a dénoncé, en décembre 2023, sa mise en place « chaotique ».
Cette libération des « opportunités économiques » ne pourra se faire que parce que « plus de Français travailleront », a expliqué le chef de l’Etat dans un second temps, rappelant son objectif de plein-emploi – autour de 5 % de chômage, contre 7,4 % actuellement.
Pour ce faire, il a annoncé l’acte II de la réforme du marché du travail, mise en place lors de son arrivée au pouvoir, en 2017. Sans entrer dans les détails, le chef de l’Etat a assuré que ce chantier serait lancé « dès le printemps ». « Le gouvernement incitera à la création et à la reprise d’un emploi », a-t-il indiqué, précisant que les règles d’indemnisation du chômage seraient « plus sévères quand des offres d’emploi sont refusées ». Un durcissement qui irait toutefois avec un « meilleur accompagnement de[s] chômeurs par la formation ».
Il vous reste 45% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.