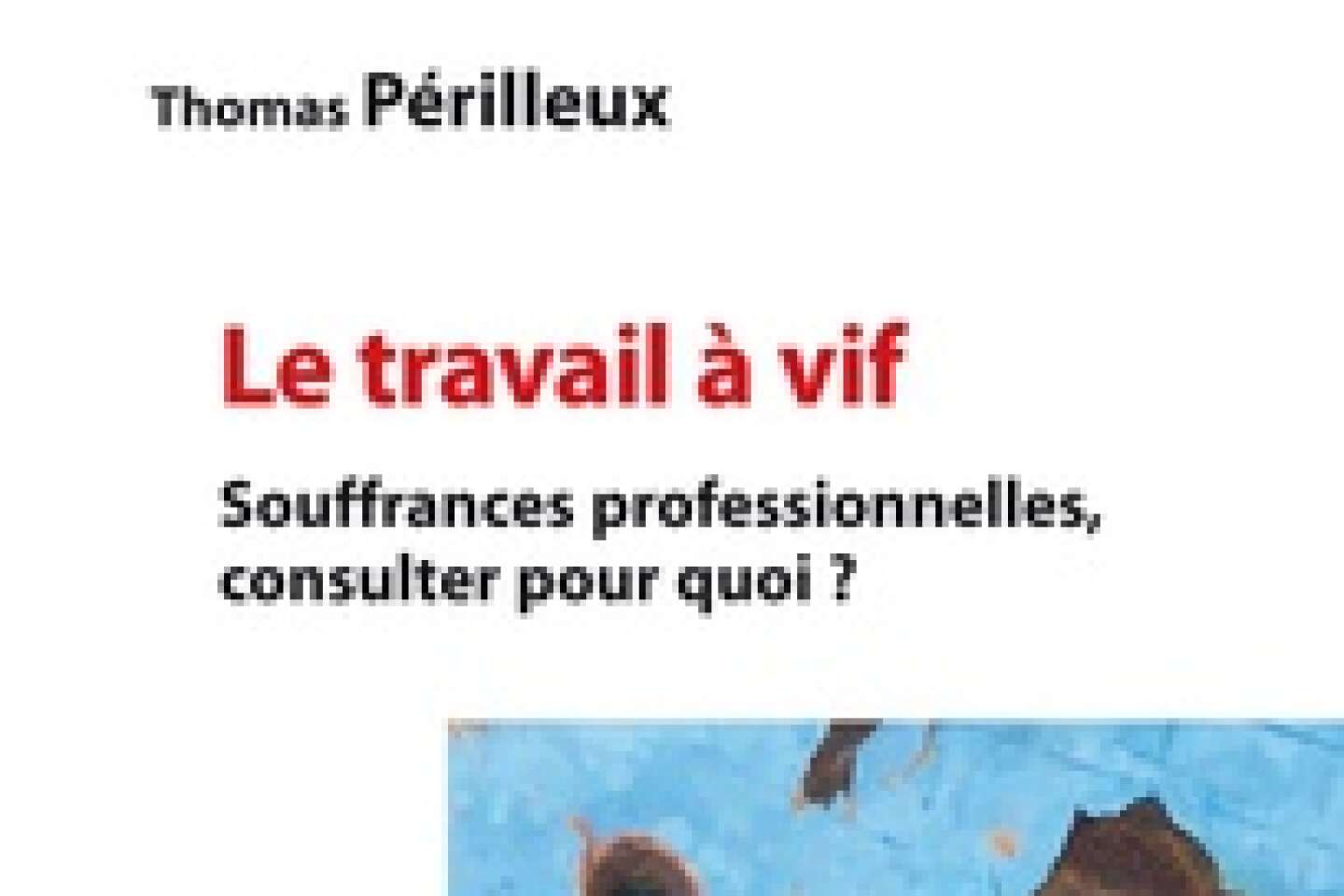« Une grande cohérence d’objectifs caractérise le train de réformes du marché du travail »

De nombreuses réformes ont été engagées sur le marché du travail ces dernières années. Plusieurs visent à augmenter le taux d’emploi, relativement bas en France comparé à d’autres pays. Une telle augmentation peut être une source d’élévation du niveau de vie moyen et de rentrées fiscales et sociales qui permettront le financement de la transition climatique, du désendettement public et d’autres réformes structurelles, par exemple dans l’éducation ou la santé.
Ces réformes ont pour objet d’augmenter le taux d’emploi des seniors pour celle des retraites, des jeunes pour celle de l’apprentissage, des peu qualifiés pour celle du RSA, et de l’ensemble des personnes d’âge actif pour celle de France Travail. Par ailleurs, la barémisation des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse permet de lever des incertitudes, sources de freins à l’embauche, en particulier pour les PME.
Une grande cohérence d’objectifs caractérise donc ce train de réformes, qui, pour certaines, ont déjà contribué au dynamisme de l’emploi en France sur les dernières années. Ces réformes pourront être ajustées en fonction des éclairages qui seront apportés par leurs évaluations. Certaines demandent d’ailleurs à être davantage précisées. Par exemple, la gouvernance à terme de France Travail demeure assez floue. D’autres ajustements paraissent souhaitables, par exemple un rapprochement des délais de contestation d’un licenciement, particulièrement longs en France, de ceux observés dans les autres pays avancés, ou bien la mise en cohérence de l’indemnisation chômage des seniors avec la réforme des retraites.
Approche technocratique
Une réforme d’une autre nature a été portée par les ordonnances travail de septembre 2017 et la loi Pénicaud de mars 2018. Elles visent à élargir l’espace du droit conventionnel résultant de la négociation collective de branche et d’entreprise au détriment du droit du travail réglementaire, par nature homogène sur l’ensemble du tissu économique et social. Le droit conventionnel permet d’adapter les normes à chaque contexte, à chaque objectif, ce qui permet une meilleure conciliation que le droit réglementaire entre efficacité économique, garantie par la signature de l’accord collectif par le chef d’entreprise, et protection des travailleurs, garantie par la signature des représentants des travailleurs légitimés par les élections professionnelles. Par cette réforme de la hiérarchie des normes, l’autonomie du tissu conventionnel est devenue effective dans les limites de ce qui relève de l’ordre public.
Il vous reste 55% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.