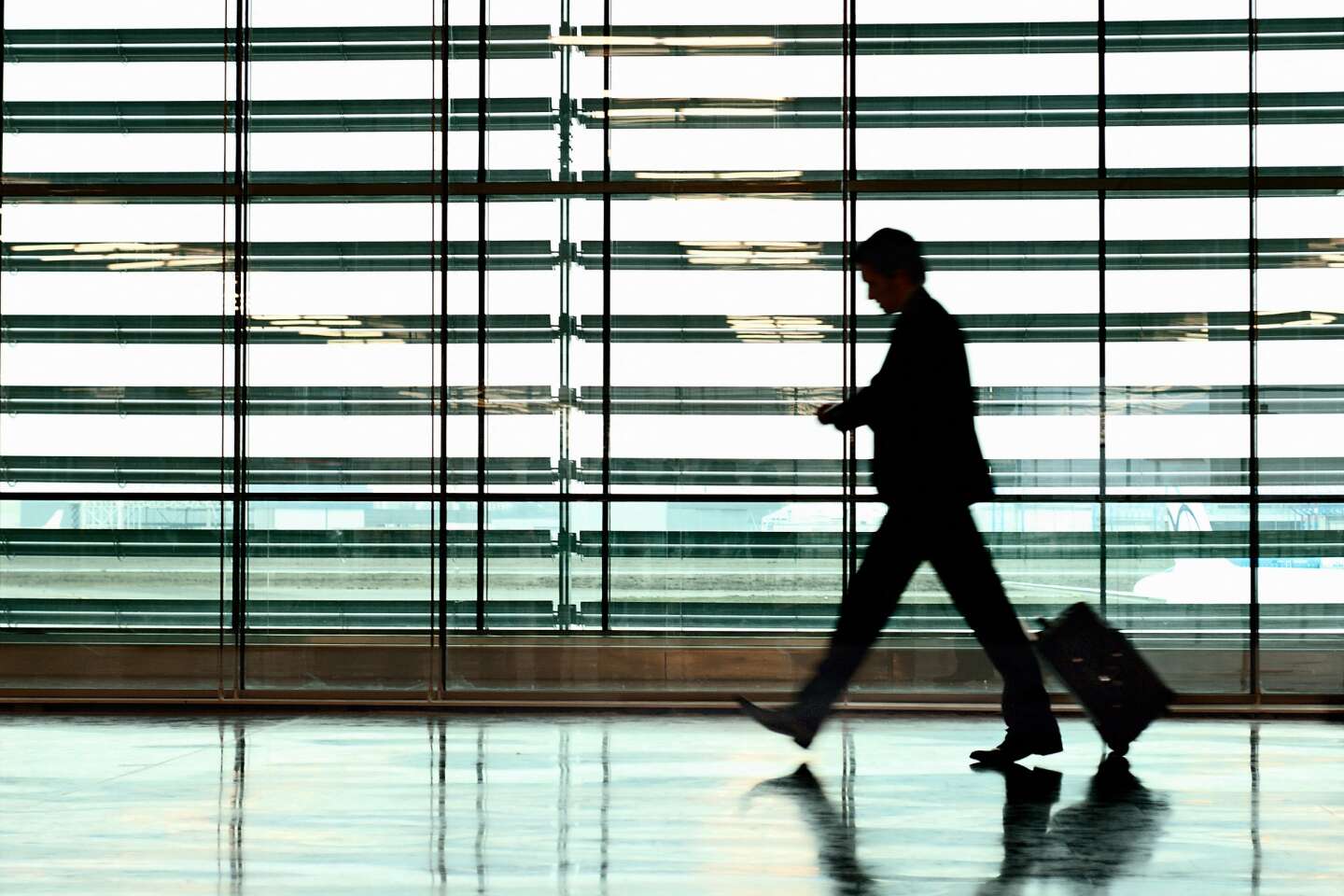Aux Etats-Unis, Lina Khan veut supprimer les clauses de non-concurrence

Greg Wier et Matthew Keywell étaient propriétaire d’une société de gardiennage, Prudential, à Taylor, près de Detroit, dans le Michigan. Leurs salariés étaient payés au lance-pierre, autour de 10 dollars (9,40 euros) de l’heure, le salaire minimum dans la région, et pourtant, les deux entrepreneurs imposaient des clauses de non-concurrence : interdiction de travailler pour un rival, de créer leur entreprise de surveillance pendant deux ans, dans un rayon de 100 miles (160 kilomètres) alentour. La sanction en cas de non-respect de ces conditions : 100 000 dollars.
Les deux hommes ne se sont pas contentés de faire signer ces contrats (en général après avoir embauché leurs gardiens, qui n’avaient plus le moyen de négocier) : ils ont fait licencier plusieurs de leurs anciens salariés embauchés dans d’autres entreprises. Tout cela pour des gardiens de sécurité ! Le cas était suffisamment emblématique pour que la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité fédérale de la concurrence américaine, se saisisse du cas et libère, début janvier, quelque 1 500 anciens salariés de Prudential de leurs obligations.
Derrière cette opération, la présidente de la FTC, Lina Khan : cette universitaire de 33 ans, fille d’émigrés pakistanais née à Londres, veut libéraliser le marché du travail américain. « Un travailleur américain sur cinq, soit 30 millions de personnes, est lié par une clause de non-concurrence », déplore Mme Khan dans une tribune au New York Times parue le 9 janvier. Elle y cite l’exemple de « travailleurs de la restauration rapide, de jardiniers, d’ouvriers » : bref, des cas de figure bien loin de celui de l’ingénieur formé pendant des années par l’entreprise et qui chiperait les secrets de fabrique.
Long chemin
« Les accords de non-concurrence font baisser les salaires et tuent l’innovation », accuse la responsable. Pas seulement les salaires de ceux qui les ont signés, mais ceux des autres, puisque ces clauses empêchent la fluidification du marché et la pression à la hausse des salaires. « Comment un nouveau business peut-il s’imposer sur le marché si tous les travailleurs qualifiés sont bloqués ? », demande-t-elle. A son secours, l’exemple de la Californie, l’un des trois Etats, avec l’Oklahoma et le Dakota du Nord, à bannir les clauses de non-concurrence, et ce depuis le XIXe siècle.
Des articles aux décisions, le chemin est long, car le gouvernement est souvent démuni aux Etats-Unis
« Cela n’a pas maintenu la Californie – la cinquième économie du monde – à l’âge de pierre », constate Mme Khan. Au contraire, ce mécanisme a permis à l’écosystème de capital-risque de prospérer dans la Silicon Valley. Ainsi, la présidente de la FTC a-t-elle tout simplement proposé la suppression des clauses de non-concurrence aux Etats-Unis, sauf en cas de cession des parts d’une entreprise, estimant que la mesure permettrait d’augmenter les salaires de plus de 250 milliards de dollars par an.
Il vous reste 53.56% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.