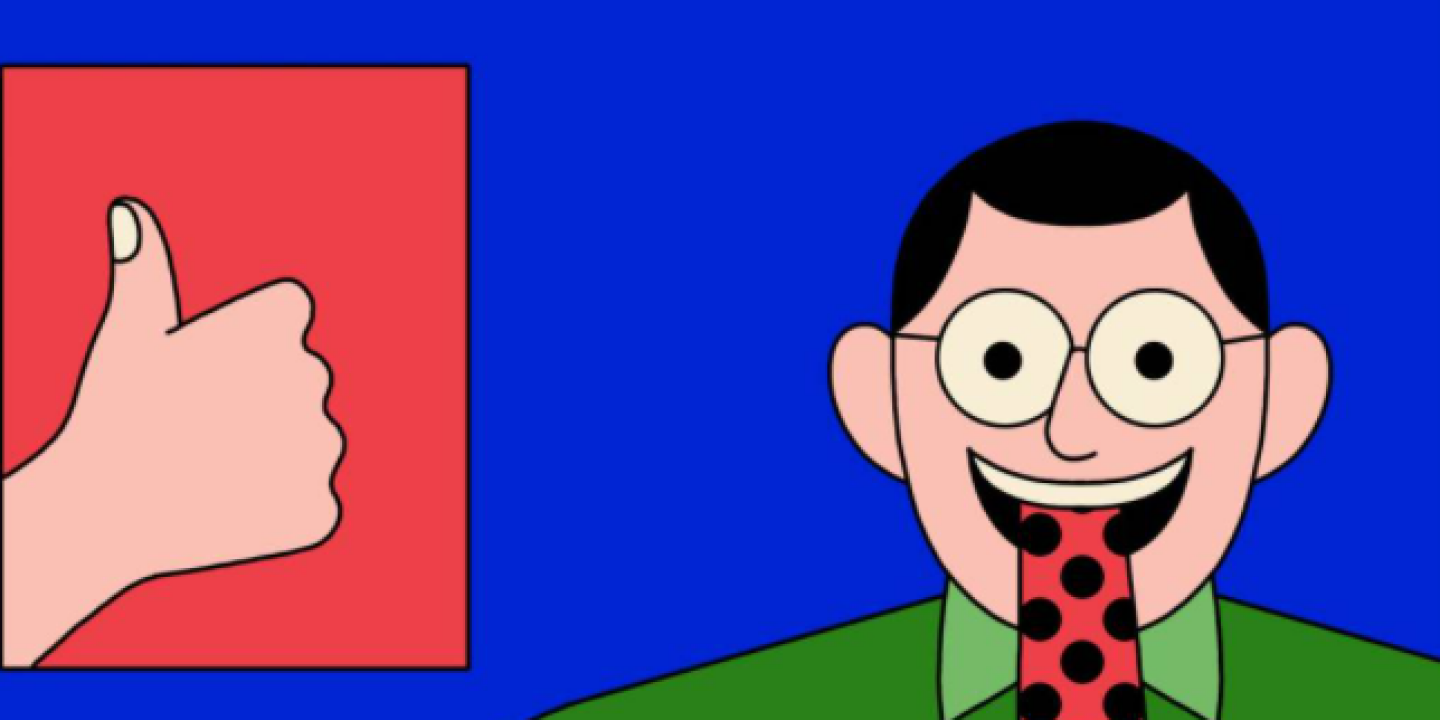RSA : « Conditionnalité et automaticité sont deux objectifs contradictoires »

Tribune. « Ce que je souhaite faire avec le RSA [revenu de solidarité active], c’est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d’engagement jeunes pour les 18-25 ans. » Alors que, depuis des mois, le gouvernement refuse d’ouvrir le RSA aux 18-25 ans, arguant que la situation des jeunes est spécifique, le candidat Macron propose aujourd’hui d’étendre les caractéristiques d’un contrat destiné spécifiquement aux jeunes… à tous les bénéficiaires du RSA !
Emmanuel Macron souhaite donc introduire une conditionnalité plus stricte pour l’obtention du RSA, avec une obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité dans un but d’insertion professionnelle – une proposition similaire à celle de sa rivale de droite Valérie Pécresse. « En même temps », il propose de verser les aides sociales « à la source », de manière automatique, afin de lutter contre le non-recours.
Ces deux caractéristiques (conditionnalité et automaticité) sont pourtant contradictoires. Les deux propositions du candidat n’atteindront pas les objectifs affichés, car le diagnostic sur lequel elles reposent n’est tout simplement pas le bon.
Commençons par la conditionnalité.
La question est récurrente à droite. Elle a fait l’objet d’une proposition de loi en 2017 portée par Guillaume Peltier, député LR et aujourd’hui vice-président de Reconquête ! Une mesure similaire a été décidée en février 2016 par le conseil départemental du Haut-Rhin (LR), sous la forme de 7 heures de bénévolat obligatoire pour toucher le RSA. La justice administrative avait annulé cette décision…
Des minima sociaux moins attractifs
Mais le Conseil d’Etat a cassé l’annulation, jugeant que le contrat d’insertion, « élaboré de façon personnalisée » peut prévoir légalement « des actions de bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatibles avec la recherche d’un emploi ». Logiquement, ces activités ne peuvent être proposées qu’aux bénéficiaires du RSA les plus proches de l’emploi, ceux engagés dans un parcours d’insertion professionnelle.
Depuis 2018, la possibilité de conditionner RSA à des heures d’activité est donc déjà possible… Il est certes possible de changer la loi, mais pour quoi faire ? Obliger les départements à contraindre les bénéficiaires du RSA à travailler ? Ce serait une vision particulière du libéralisme et de la décentralisation… Assouplir le cadre législatif ? Aujourd’hui, il est cohérent : les obligations doivent se faire dans un souci réel d’insertion ; il ne s’agit donc pas de casser des pierres au bord de la route afin de punir ou de stigmatiser.
Il vous reste 63.82% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.