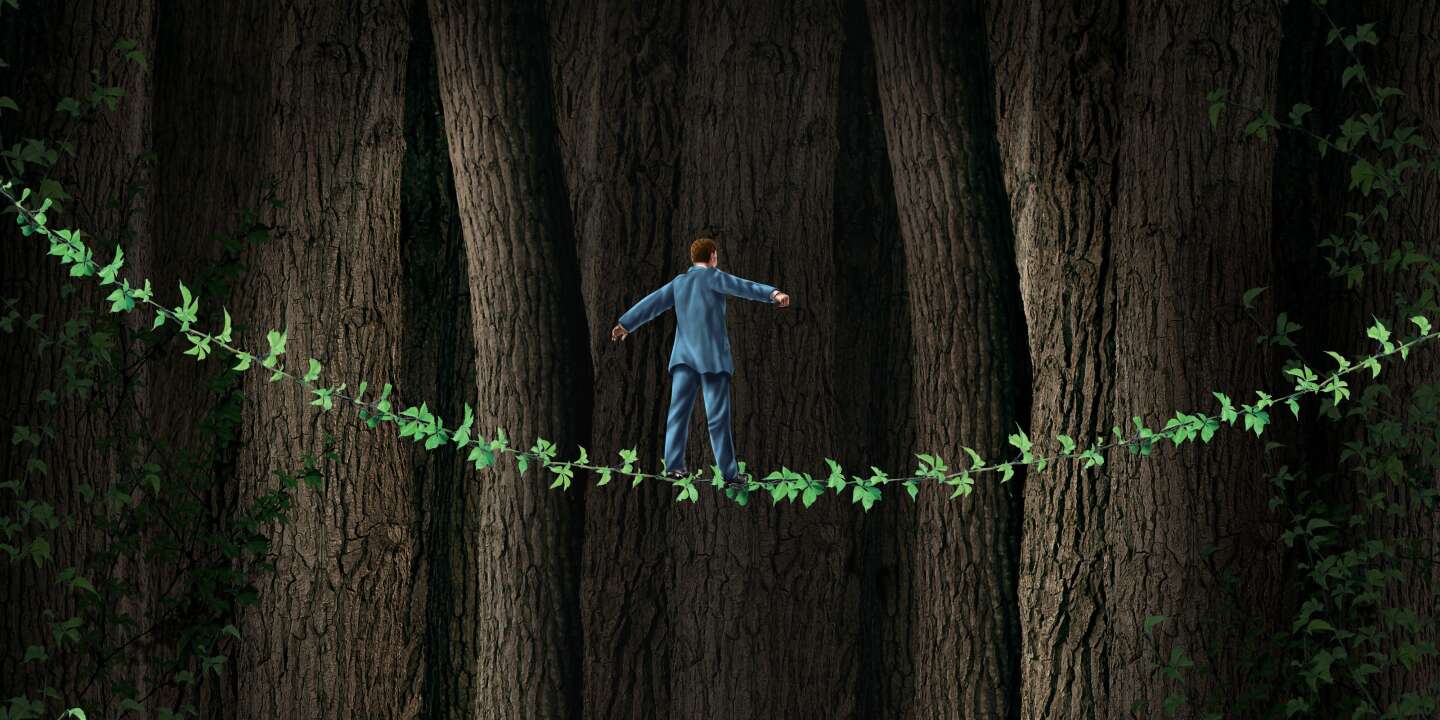A Marmande, la reprise réussie d’un « petit patron métallo »
Fragments de FranceIl y a huit ans, Alain Bonnet a repris Meca d’Aquitaine, une petite usine de transformation de tubes en acier dans le Lot-et-Garonne. Responsable de 17 salariés, il vit au rythme des commandes, des embauches et des mutations du métier.
« Cinq mille pièces, douze minutes de soudure par pièce, presque six mois de boulot pour un soudeur… » Calculatrice en main, croquis étalés sur son bureau, Alain Bonnet jongle avec les chiffres et les plannings pour établir un devis. Cinq mille inserts métalliques à fabriquer pour des sièges de cinéma. « J’ai intérêt à regarder si je peux le faire avec notre robot, ça diviserait le coût par trois », note-t-il. Par la grande baie vitrée, la brume matinale noie encore la zone pavillonnaire de Marmande (Lot-et-Garonne), au bout de laquelle seul un panneau « Sortie d’usine » signale les bâtiments bas en tôle ondulée de sa PME, Meca d’Aquitaine.
Voilà huit ans que cet ancien « ingénieur métallo » a repris cette entreprise en faillite. Chaises et tables pour des chaînes de restaurant, poussettes d’aéroport, lits à barreaux pour hôpitaux pédiatriques ou fauteuils ergonomiques à destination des Ehpad : chez Meca, répondre à une commande demande au dirigeant non seulement de vérifier le calendrier de ses 17 salariés – dont quatre cadres et un apprenti – mais aussi, bien souvent, de concevoir les produits qui seront découpés, soudés et peints à partir de tubes d’acier, avant d’être livrés en pièces détachées ou entiers à ses quelque 80 clients, industriels ou intermédiaires spécialisés. A 61 ans, le patron a abandonné la cravate depuis une dizaine d’années – « mon fils m’a dit un jour : papa, tu es un industriel, pas un banquier ! » –, mais vient tous les matins en chemise et pantalon de costume. « Quand j’ai repris la boîte, un copain chef d’entreprise m’a dit : “Bienvenue, tu deviens un connard de patron !” Moi, ça m’a rien changé. Les gens font la différence entre les petits patrons comme nous et ceux du CAC 40 : l’un met ses billes dans sa boutique, l’autre pas. »

Le bleu de travail de cet ancien d’Usinor-Sacilor, l’un des grands noms de la métallurgie des « trente glorieuses », est d’ailleurs toujours pendu au portemanteau. Au cas où. « En juillet, on a fait notre plus gros mois depuis la reprise de la boîte, il est venu aider. Les gars l’ont un peu chambré, mais ils ont bien aimé. Il a fallu quelques années, mais maintenant ils adhèrent au projet. » Peau burinée, barbe poivre et sel et tee-shirt maculé de sueur, Jean-Louis Barault, le doyen des cadres de Meca, est directeur opérationnel et partage le bureau d’Alain Bonnet. Ce matin, il a surtout aidé un de ses « gars » à porter des supports de groupes électrogènes brûlants, tout juste terminés. « Je n’allais pas le laisser faire ça tout seul ! Si c’est pour qu’il soit en vrac le lendemain… » Les risques du métier, ce Rochelais d’origine, fils de scaphandrier, qui a commencé à travailler dans l’usine en 1982, à l’âge de 18 ans, ne rigole pas avec.
Il vous reste 78.6% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.