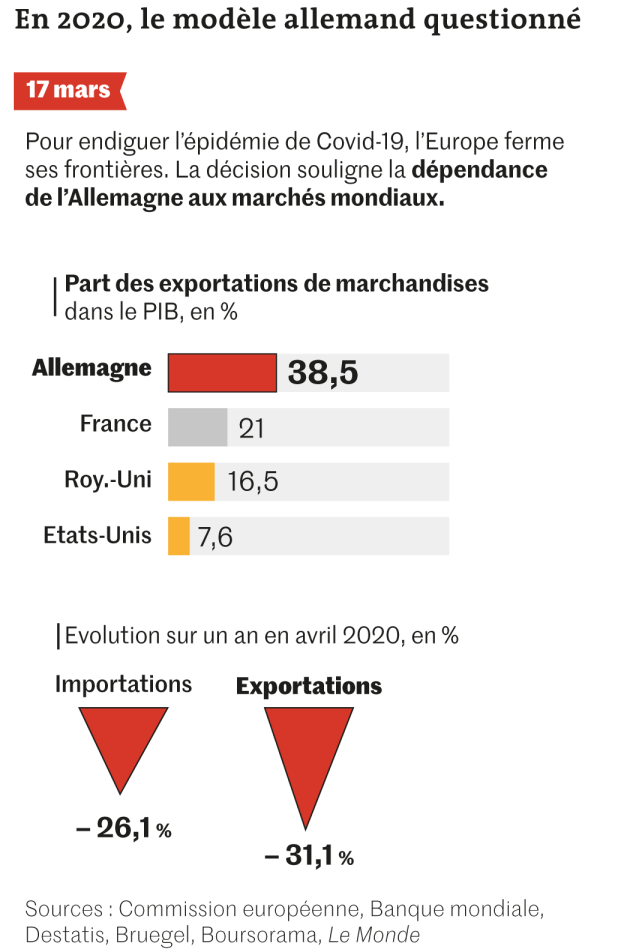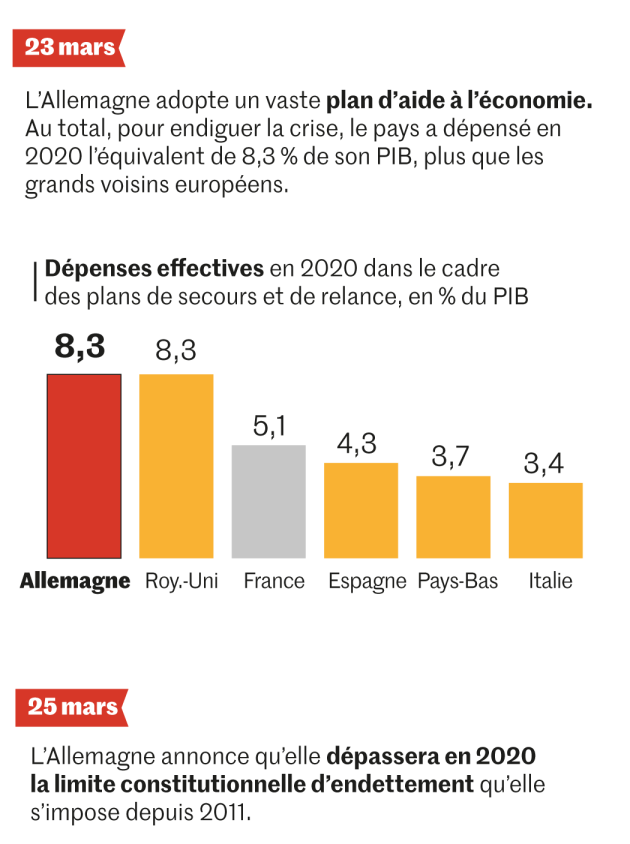Joe Biden lance la bataille du salaire minimal aux Etats-Unis

Joe Biden a décidé de doubler le salaire minimal fédéral à 15 dollars (12,30 euros). Ce salaire fut instauré en 1938 par Franklin Delano Roosevelt pendant la Grande Depression mais il est devenu théorique ; son niveau est si bas – 7,25 dollars de l’heure depuis 2009 – qu’il concerne moins de 2 % des 80 millions de travailleurs américains payés à l’heure, soit 1,6 million de personnes. Si elle était étalée jusqu’en 2025, cette hausse entraînerait une augmentation de salaire directe pour 23 millions d’Américains, soit plus de 15 % de la population active, selon David Cooper, économiste à l’Economic Policy Institute (EPI).
La mesure n’est pas acquise, car elle doit être approuvée à 60 % par le Sénat, dans lequel les républicains détiennent la moitié des sièges. Mais la dynamique politique est forte sur le terrain. Depuis des années, faute d’action fédérale, ce sont les Etats et collectivités locales qui ont augmenté le salaire minimum local. En 2021, plus de 20 Etats auront augmenté le leur. Dernière à rejoindre le mouvement, la Floride a décidé par référendum en novembre 2020 de passer de 8,56 à 15 dollars d’ici à 2026.
Les écarts territoriaux restent considérables : la rémunération minimale locale est au plus haut dans les riches régions démocrates (San Franciso, 16,07 dollars, Seattle et New York (15 dollars), Californie (13 dollars) et au plus bas dans le Wyoming ou en Géorgie (5,15 dollars). Entre salaire minimal fédéral et local, c’est le plus élevé qui s’applique. Ainsi, une grande partie du chemin vers les 15 dollars a été de facto accomplie : au total, le salaire minimal « moyen » aux Etats-Unis était en 2019 de 11,80 dollars, selon l’économiste Ernie Tedeschi. Les entreprises ont bougé elles aussi : Amazon a augmenté sa rémunération à 15 dollars sous la pression politique et face au manque de main-d’œuvre.
Amazon a augmenté sa rémunération
à 15 dollars sous la pression politique
et face au manque de main-d’œuvre
La révolution Biden ne changera rien dans les régions riches au salaire local élevé, mais elle va entraîner une révolution dans les Etats les plus pauvres du Sud et du Midwest et auprès des minorités. Selon l’EPI, la hausse toucherait 28 % des salariés d’Alabama, de Louisiane et d’Arkansas, 26 % en Floride ou dans le Montana, mais personne en Californie et 1,4 % seulement dans l’Etat de New York. Elle bénéficierait à 25 % des Noirs, 20 % des Hispaniques et 13 % des Blancs. Dans la restauration et de l’hôtellerie, 40 % et 33 % des salariés en profiteraient, contre 3,7 % des employés du public et 10 % des salariés souvent syndiqués de l’industrie et de la construction. Le gain annuel moyen serait de 3 580 dollars, soit de 20 %. S’y ajoutent les gains de 2 760 dollars pour 10 millions de salariés payés au-dessus de 15 dollars et dont la rémunération serait poussée à la hausse par la dynamique du smic.
Il vous reste 56.27% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.