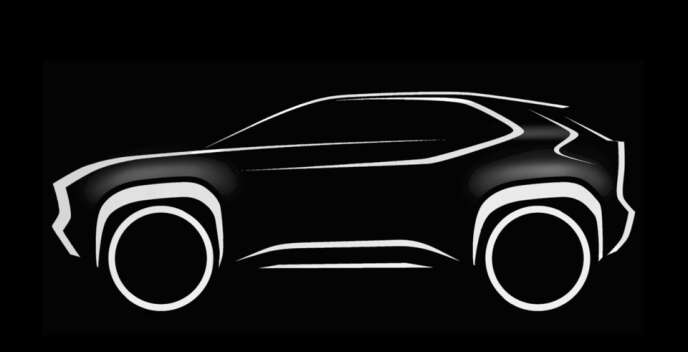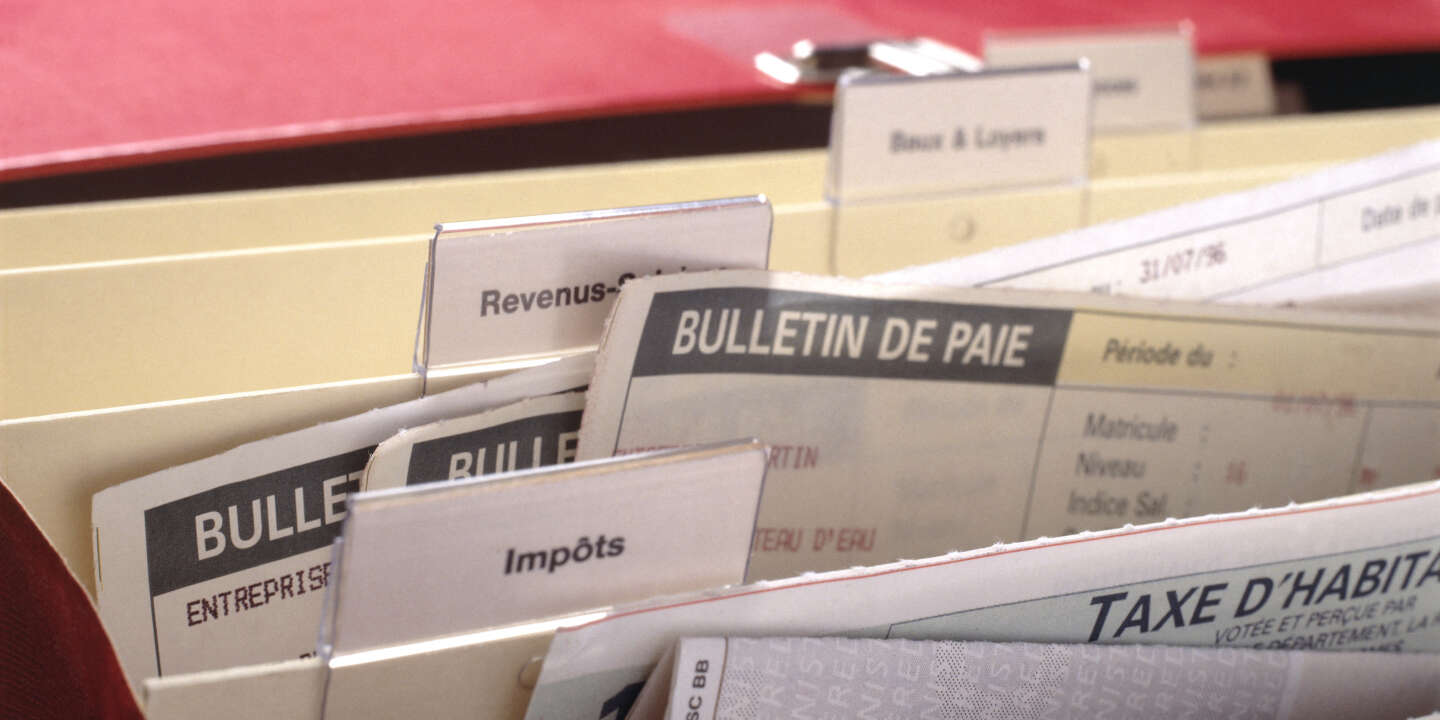Cinq ans après son introduction, un bilan mitigé pour le smic en Allemagne

Destruction de près d’un million d’emplois, faillite de nombreuses entreprises familiales, ruine de l’agriculture, érosion de la compétitivité de l’économie nationale, bureaucratie excessive… Il y a six ans, le débat sur l’introduction d’un salaire minimum faisait rage en Allemagne. Les détracteurs du smic ne manquaient pas d’arguments contre cette réforme portée par le Parti social-démocrate (SPD) et qui, selon le gouvernement, devait concerner 3,7 millions de salariés.
La loi, finalement adoptée par le Bundestag (Chambre basse du Parlement) en juillet 2014 après de longs atermoiements, prévoyait l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, d’un smic de 8,50 euros brut de l’heure pour tout salarié âgé de plus de 18 ans. De nombreuses dérogations prévues par le texte – dans l’agriculture, le textile, la restauration ou encore l’intérim – étaient appelées à disparaître au plus tard en 2018. Mais si, selon plusieurs sondages réalisés à l’époque, près de 90 % des Allemands se disaient en faveur de cette réforme, les économistes étaient bien plus circonspects.
« Mini-jobs »
La plupart des experts redoutaient que cela ne provoque des centaines de milliers de licenciements. « Le salaire minimum met en danger jusqu’à 900 000 emplois », avait ainsi prédit l’économiste vedette Hans-Werner Sinn, ancien président de l’institut de conjoncture munichois, Ifo. Pour sa part, Axel Börsch-Supan, expert à l’institut Max-Planck à Munich, craignait que la nouvelle loi ne « fasse exploser le chômage des jeunes » de moins de 25 ans.
Cinq ans après la mise en place du smic, le chômage a poursuivi sa longue décrue, pour tomber de 6,7 % en 2014 à 5 % en 2019
Cinq ans après la mise en place du smic, ces craintes se sont révélées infondées. Le chômage a poursuivi sa longue décrue, pour tomber de 6,7 % en 2014 à 5 % en 2019, tandis que le nombre d’actifs a continué de battre record sur record. Ainsi, en novembre 2019, l’office fédéral de la statistique Destatis recensait 45,5 millions d’actifs occupés outre-Rhin : cela correspond à plus de 2,8 millions d’emplois créés depuis fin 2014. Et l’économie allemande, très tournée vers l’exportation, a continué à dégager de confortables excédents commerciaux. En effet, le salaire plancher n’a pas eu d’impact sur la compétitivité de l’industrie allemande, les salaires étant généralement très élevés dans ce secteur.
Malgré ce bilan rassurant, plusieurs études ont établi que l’introduction du salaire minimum a probablement eu un effet légèrement négatif sur le marché du travail : entre 50 000 et 140 000 emplois auraient été perdus à cause de la réforme. Et il s’agit avant tout de « mini-jobs », ces emplois à temps partiel créés par les réformes de l’ancien chancelier Gerhard Schröder (1998-2005), sans protection sociale et rémunérés 450 euros par mois. Les chercheurs jugent donc très limité l’impact de la réforme. « En termes d’échelle, cela se situe dans la fourchette de la dispersion statistique », résume Bernd Fitzenberger, économiste à l’université Humboldt de Berlin.