Mutation dans le travail, un inventaire désordonné, mais positif
Si le monde du travail éprouve des mutations profondes, il est très difficile d’annoncer l’avenir. La peur que la technologie tue le travail est un polémique ancienne, auquel les auteurs de « Les robots n’auront pas notre peau ! », portent leur participation.

L’âge industriel fut défini par le passage graduel d’une économie agricole à une économie industrielle, avec les conséquences sociales et culturelles que l’on connaît. L’âge de l’information, qui a connu à la fin des années 1990 la généralisation d’Internet et des nouvelles technologies de communication, change, à son tour, la façon dont nous vivons et travaillons aujourd’hui. « La différence est que ces transformations interviennent vite alors que ceux impulsés par la révolution industrielle ont eu deux siècles pour s’installer. Il en résulte une inadéquation entre les façons de travailler des entreprises traditionnelles et l’époque dans laquelle nous vivons », remarquent Laurent Geneslay et Rasmus Michau dans Les robots n’auront pas notre peau ! Ce qui va transformer dans l’entreprise à l’heure de l’IA.
S’il est véritable que le monde du travail connaît des transformations profondes, il est très difficile de prévenir l’avenir. L’homme sera-t-il au service des robots ? La peur que la technologie tue le travail est une polémique ancienne. Au XIXe siècle déjà, le mouvement luddite, en Angleterre, luttait contre les machines à tisser de la révolution industrielle, de peur que celles-ci annulent les emplois.
Actuellement, la crainte d’un monde où les robots se remplaceront à l’homme est toujours présente. Elle est même au cœur du best-seller de Yuval Harari, Homo deus (Albin Michel, 2017), qui prédit un avenir où les algorithmes, devenus intelligents, auront créé une existence autonome, réduisant l’homme à un simple moyen au service de l’information, religion suprême que ce professeur de l’université de Jérusalem nomme le dataïsme.
Environnement, santé ou encore économie ; les disruptions sociétales auxquelles nous pouvons nous attendre se placent à de multiples niveaux. Les auteurs, serial entrepreneurs, ne veulent pas fournir de réponse à la question « que nous réserve l’avenir ? », mais de préférence retracer le monde du travail actuel et fournir certains principes d’analyse sur une évolution qui nous semble inéluctable.
Une baisse du rendement depuis vingt ans
Le tout, sur un ton résolument optimiste. D’après une étude du McKinsey Global Institute de février 2018, les gains de rendement potentiels liés aux changements numériques seraient encore loin d’être absolument matérialisés. Aux Etats-Unis, l’économie n’aurait accompli son potentiel digital qu’à hauteur de 18 %, et l’Europe à 12 %.





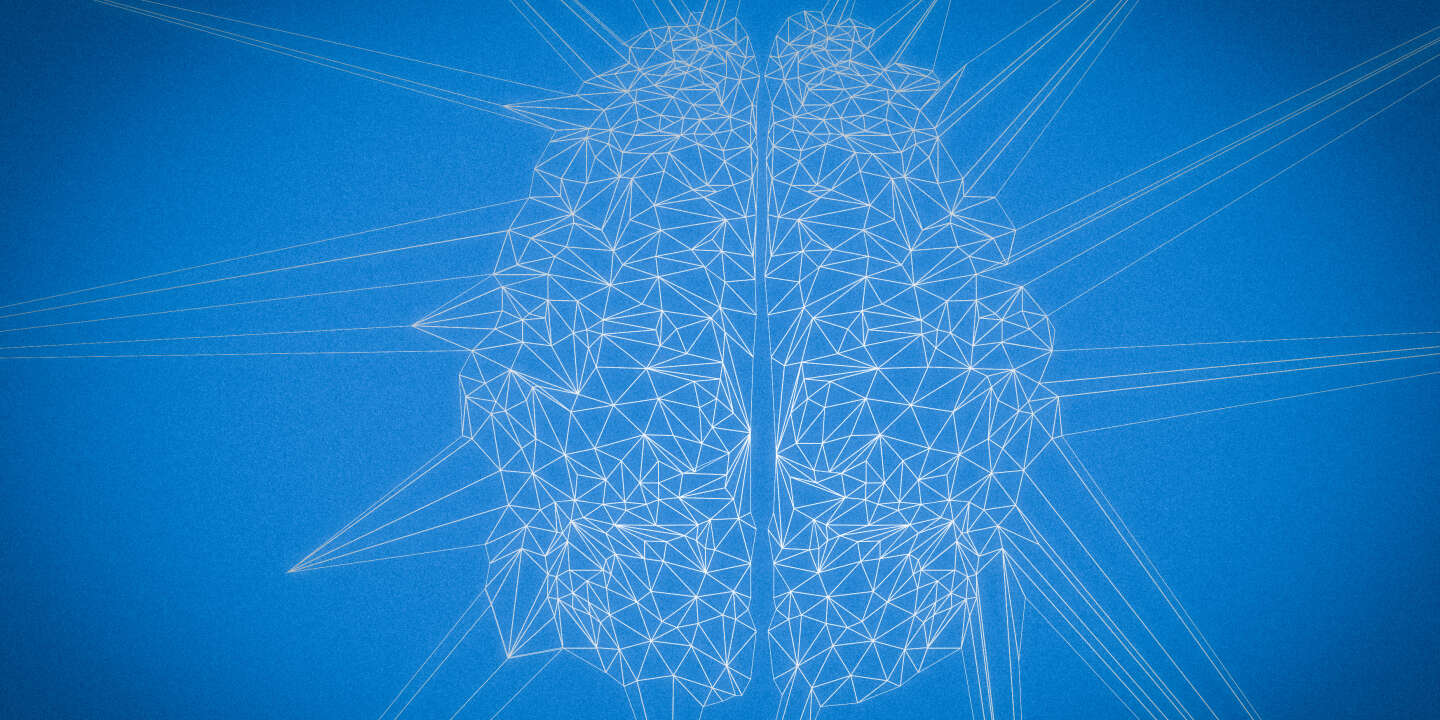

Les attentes d’une reprise de l’usine girondine de Blanquefort ont été douchées dans la nuit de lundi à mardi pour les 850 travailleurs de Ford. La direction régionale des entreprises, de la compétition, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a validé le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui scelle la clôture de l’usine.
Dans un communiqué, Ford-France a accueilli une « étape importante », qui admet de « lever une partie des incertitudes qui pesaient sur [ses] employés quant à leur avenir ». La fabrication de boîtes de vitesses, qui tourne depuis des mois au ralenti, devrait arrêter fin août, selon les syndicats.
Dès mardi matin, la CGT (Confédération générale du travail) de cette usine des environs de Bordeaux, dont le délégué est l’ancien candidat à la présidentielle de 2017 Philippe Poutou, a éclairci son intention de critiquer ce plan devant le tribunal administratif. « Le PSE n’a aucun fondement, aucune justification économique. Tout le monde le sait, tout le monde l’a dit durant cette dernière année, a dénoncé le syndicat dans un jugement. Ce que le gouvernement n’a pas pu faire ou pas su faire ou pas voulu faire, nous allons le tenter. Nous allons attaquer en justice pour faire invalider ce PSE. »
« Le risque de la précarité »
Selon des sources syndicales, une part croissante du personnel – quoique blessée par l’indifférence du fabricant américain – avait peu à peu basculé en faveur du PSE, à la fois pour ses conditions jugées plutôt correctes pour le secteur (métallurgie) et par lassitude des faux espoirs soulevés par l’offre de reprise du strasbourgeois Punch Powerglide, reportée deux fois par Ford.
Aux termes du PSE, dont une première version avait été rejetée fin janvier, entre 300 et 400 salariés selon des sources syndicales pourraient être éligibles à la préretraite, dans une usine où la moyenne d’âge est de 51 ans, quelques dizaines d’autres reclassés dans l’usine voisine GTF, détenue par Ford et le canadien Magna. Le reste du personnel, environ 400 à 500 salariés, devrait être licencié avec deux à trois ans d’accompagnement et de couverture chômage, selon les syndicats. Mais pour les moins reclassables et loin de la retraite, « le risque de la précarité » est au bout de ce délai, selon la CGT.
Le PSE, selon des retours proches du dossier, porterait sur une moyenne de 190 000 euros par salarié. Un chiffre contredit par les syndicats, pour lesquels ce « budget » moyen masque en outre de fortes disparités. Ford a pour sa part salué un plan social « très complet » qui comprend « à la fois un plan reclassement et de retraite anticipée » et « des mesures visant à aider les salariés à retrouver un emploi salarié, à créer leur propre entreprise ou encore à profiter de formations de reconversion ».
Le constructeur américain va servir les 20 millions d’euros pour « réindustrialiser »
Bercy a éclairci mardi que le constructeur versera les 20 millions d’euros sollicités par le gouvernement pour la réindustrialisation du site de Blanquefort, réaffirmant une information du Parisien. « C’est carton plein sur ce qu’on demandait et ce qu’ils vont payer », a déclaré le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, au quotidien. Le ministre restitue avoir dit à Ford : « Soit vous payez, soit vous demeurerez collés pendant des années avec des valeurs judiciaires et des difficultés administratives », selon ses propos cités par Le Parisien.
Vendredi, à Bordeaux, le Président de la République avait assuré que l’Etat allait « forcer » Ford à payer pour la revitalisation du site de l’usine. Un discours repris le lendemain par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, affirmant que le gouvernement était en mesure de peser sur le constructeur pour le pousser à investir « plusieurs millions » d’euros afin de garantir la reconversion de l’usine. Dimanche, dans Le Parisien, Bruno Le Maire avait éclairci avoir demandé 20 millions d’euros à Ford pour « réindustrialiser » le site.
Le fabricant avait avisé en février 2018 son désir de se désengager de Blanquefort, usine introduite en 1972, qui a employé jusqu’à 3 600 salariés. Mais la fermeture devrait avoir des conséquences de façon plus large sur l’emploi girondin, en raison, selon les syndicats, d’environ 2 000 emplois induits.