« Une hausse du smic pourrait admettre de corriger un peu les déséquilibres »

Le gouvernement Français a confirmé qu’il n’était pas question d’augmenter le smic au-delà de sa hausse légale (du moins jusqu’à nouvel ordre). Pourtant, on remarque, depuis plusieurs décennies à une captation des fruits de la croissance économique par les plus riches. Les mesures récentes prises par l’exécutif ne risquent pas d’améliorer les choses. L’Institut des politiques publiques a chiffré en octobre l’impact des mesures budgétaires pour l’année 2018-2019 : les 20 % les plus pauvres enregistreront une perte de revenu disponible pouvant atteindre 1 %, tandis que les 1 % les plus riches gagneront jusqu’à 6 % de pouvoir d’achat.
Une hausse du revenu minimum pourrait permettre de corriger un peu cette aliénation. Le premier ministre a pourtant balayé cette option d’un revers de main, avec un argument parfaitement nébuleux. Selon lui, « notre politique, ce n’est pas de faire des coups de pouce au smic, notre politique c’est de faire en sorte que le travail paie ». Evidemment, si l’on augmente le smic, le travail paiera davantage. Mais le premier ministre s’appuie semble-t-il sur l’argument, développé par certains économistes, qu’une augmentation du smic entraînerait une diminution de l’emploi ou des heures travaillées, et par conséquent une diminution des revenus.
Pourtant, un grand nombre de travaux, dans la lignée de l’ouvrage célèbre de David Card et Alan Krueger (Myth and Measurement : The New Economics of the Minimum Wage, Princeton University Press, 1995), ont affirmé que cette thèse libérale en vogue dans les années 1980 était fausse. Non seulement une augmentation du salaire minimum ne nuit pas à l’emploi, mais elle peut même l’améliorer. Une étude d’Arindrajit Dube (Université du Massachusetts à Amherst) et de ses collègues (« The Effect Of Minimum Wages on Low-Wage Jobs » Centre for Economic Performance, Discussion Paper, n° 1531, février 2018) analyse l’impact de 138 hausses significatives (10 % en moyenne) du salaire minimum aux Etats-Unis entre 1979 et 2016. Lorsque le salaire minimum augmente, on observe que la disparition des emplois rémunérés au-dessous du nouveau salaire minimum est plus que compensée par l’augmentation du nombre d’emplois (y compris en équivalents temps plein) rémunérés jusqu’à 5 dollars au-dessus du nouveau salaire minimum.




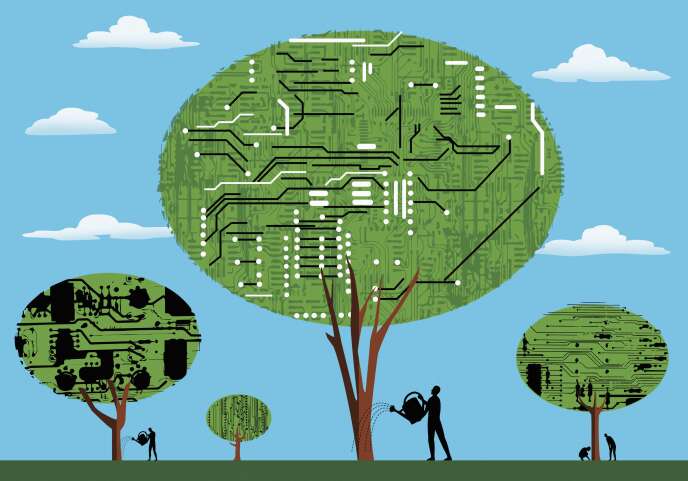




L’objectif fondamental de la Cour était d’évaluer les effets de la réforme de 2014, et de jauger de l’efficacité et de la sincérité du contrat de performance 2017-2026, effectué entre l’Etat et SNCF Réseau il y a deux ans. Mais, bousculés par le calendrier, les magistrats financiers ont fait preuve de souplesse en intégrant à leur travail les effets supposés de la réforme de 2018, ce « pacte ferroviaire » voulu par Emmanuel Macron et Edouard Philippe.
Leur constat est préoccupant. Malgré plus de dix ans de prise de conscience, malgré la réorganisation de 2014 qui a abouti, entre autres, à la création de SNCF Réseau, malgré les 46 milliards d’euros d’investissements inscrits dans le contrat de performance, le réseau ferré de France n’est pas tiré d’affaire. Certes, la spirale du vieillissement a été stoppée par les efforts de remise en état entrepris lors du quinquennat Hollande (30,5 ans d’âge moyen de la voie en 2016 contre 32,4 ans en 2013) mais, pour reprendre une formule du rapport, « le modèle financier est en échec ».
Gros besoins d’investissements
Au premier lieu des accusés : l’Etat-investisseur qui ne l’est pas suffisamment, selon la Cour. L’exemple le plus frappant concerne toujours ce fameux contrat de performance 2017-2026, présenté lors de sa publication comme l’outil clé de réparation d’un système ferroviaire malade. Ce dernier prévoyait, rappellent les magistrats, « de porter les investissements annuels de renouvellement à 3 milliards d’euros en 2020 pour ensuite se stabiliser. La Cour constate toutefois que, retraité en euros constants, ce choix revient de fait à réduire les efforts d’investissement dès 2020 et à atteindre à partir de 2022 un niveau inférieur à 2017. »
Mais il y a pis. Les mesures financières majeures introduites lors des débats sur la réforme ferroviaire semblent insuffisantes. L’annonce d’une augmentation des investissements de 200 millions d’euros supplémentaires par an à compter de 2022 ? « Cet effort supplémentaire ne répondra pas à tous les besoins de rénovation et de modernisation du réseau », dit le rapport. La reprise de dette de 35 milliards d’euros par l’Etat entre 2020 et 2022 ? « Cette mesure n’est pas suffisante, répondent les magistrats. Les besoins d’investissements sont tels dans les années à venir que SNCF Réseau ne peut les couvrir par son seul autofinancement, même avec d’importants efforts de performance. La couverture (…) de ces investissements par l’Etat est une nécessité au risque de voir la dette du gestionnaire d’infrastructure se reconstituer. »
Conclusion : reprenant à son compte le chiffre avancé par SNCF Réseau de la nécessité de disposer de 3,5 milliards d’euros d’investissement chaque année (soit 500 millions de plus que la programmation), la Cour des comptes invite l’Etat à investir au-delà des efforts annoncés.
Problèmes de modernisation
Mais le gouvernement n’est pas le seul à être interpellé. SNCF Réseau est aussi critiqué pour ses difficultés à se moderniser : projets en retard et en surcoût (en particulier, le programme de commande centralisée des aiguillages décidé en 2006 et dessiné seulement en 2013), gains de rendement peu consistants lorsqu’on les mesure en nombre de personnes employées par métier. Les magistrats accordent tout de même quelques satisfécits à la direction actuelle, en particulier sur sa capacité à recourir à du matériel technique puissant et efficace comme les trains usines pour renouveler la voie ou les mégagrues ferroviaires pour poser des aiguillages monumentaux.
Alors que faire ? Dans ses recommandations, l’institution insiste sur l’importance du futur contrat de performance qui liera l’Etat à SNCF Réseau : sur sa précision, sa sincérité, sa crédibilité. Il sera la façon de transformer l’essai de la réforme. La Cour exhorte aussi les protagonistes (SNCF Réseau, Etat, personnel) à profiter du moment – la mise en place concrète de la nouvelle réforme – pour discuter des accords sociaux qui n’entravent pas l’entreprise. Et elle suggère de regarder en face le devenir des petites lignes ferroviaires peu utilisées. Un sujet politiquement compliqué, qui devrait faire l’objet d’un autre rapport de la Cour des comptes en 2019.